-
Partager cette page
Axe 2 : L'Antiquité imaginée. Les références antiques dans la création artistique, littéraire et poétique (XVIe-XXIe siècles)
Si l’Antiquité n’a jamais véritablement disparu de la culture occidentale, c’est à partir de la Renaissance qu’apparaît la volonté de « restituer » le monde antique dans tous ses aspects. Cependant, la frontière entre volonté de connaissance objective de l’Antiquité et mobilisation des références antiques au service de la production d’œuvres littéraires et d’œuvres d’art n’a en réalité jamais été abolie. En ce début de XXIe siècle, l’Antiquité nourrit encore, voire plus que jamais, l’imaginaire de nombreux créateurs, sur des supports désormais plus variés qu’aux siècles précédents.
Quelle que soit la manière dont les références antiques se trouvent ainsi mobilisées, on peut s’interroger sur le ou les sens de cette utilisation de l’Antiquité dans les œuvres de fiction : que nous apprend-il sur le rapport à l’Antiquité des sociétés modernes et contemporaines, sur le statut de l’Antiquité et son évolution dans le monde occidental, depuis le XVIe siècle jusqu’à nos jours ? C’est sur les formes et les détours de cette « translatio plus ou moins involontaire » selon l’expression de P. Galand (L’Antiquité dans l’imaginaire contemporain. Fantasy, science-fiction, fantastique, dir. M. Bost-Fievet et S. Provini, Paris, 2014), qu’il s’agira de s’interroger.
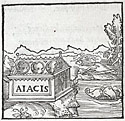 Cet axe pourra alimenter le séminaire commun CRATA-ERASME, en proposant d’explorer quelques aspects des « imaginaires antiques », à la fois dans l’Antiquité et dans sa réception. Par ailleurs, cet axe comprend la réalisation d’un site pédagogique pour faire lire du latin à partir de corpus poétiques et fictionnels néo-latins illustrés de la Renaissance, dans le cadre du projet IUF d’A.-H. Klinger-Dollé, avec la collaboration de deux doctorantes du CRATA (B. Chachuat et S. Patané), de P. Chiron (ELH) et d’étudiants de Master : https://imago.langues-anciennes.be/.
Cet axe pourra alimenter le séminaire commun CRATA-ERASME, en proposant d’explorer quelques aspects des « imaginaires antiques », à la fois dans l’Antiquité et dans sa réception. Par ailleurs, cet axe comprend la réalisation d’un site pédagogique pour faire lire du latin à partir de corpus poétiques et fictionnels néo-latins illustrés de la Renaissance, dans le cadre du projet IUF d’A.-H. Klinger-Dollé, avec la collaboration de deux doctorantes du CRATA (B. Chachuat et S. Patané), de P. Chiron (ELH) et d’étudiants de Master : https://imago.langues-anciennes.be/.Dans ce cadre est aussi mis en place un groupe de recherche « Dans l’œil des antiquaires » (V. Krings, avec H. Morvan, université Bordeaux-Montaigne) dont l’objet est de réunir des universitaires et des personnes extérieures à l’université qui sont confrontés à la documentation antiquaire et à sa mise en valeur. Enfin, les trois responsables de cet axe souhaitent s’engager dans la rédaction d’un ouvrage réellement collectif sur cette thématique, étoffé de contributions extérieures, en se dégageant du modèle classique colloque universitaire / publication d’actes, qui nous semble trop souvent juxtaposer les contributions. On tendra à une rédaction à plusieurs voix harmonisées, à l’aide de 4-5 rencontres préparatoires à l’élaboration de l’ouvrage final.
En 2019, est sorti de presse l’ouvrage collectif L’Antiquité imaginée. Les références antiques dans les œuvres de fiction (XXe-XXIe siècles) (Bordeaux, Éditions Ausonius), co-édité par Carine Giovénal, Véronique Krings, Alexandre Massé, Matthieu Soler et Catherine Valenti, qui reprend les interventions du séminaire de l’équipe.
Paru dans Anabases 29 (printemps 2019), l’atelier « Les Gaulois au musée », coordonné par Aurélie Rodes et Catherine Valenti, reprend les conclusions d’une journée d’études organisée au musée Saint-Raymond (Toulouse), autour des interrogations suivantes : Quelle image les structures muséales souhaitent-elles donner des Gaulois ? Leurs propositions sont-elles consciemment établies en opposition aux stéréotypes dix-neuvièmistes ? Quelles sont les sources d’inspiration des muséographes, et laissent-elles la place à une part d’imagination ?
L’antiquarisme et son insertion dans un horizon matériel, intellectuel et imaginaire a été exploré par le biais d’un ouvrage collectif, L’Antiquité expliquée et représentée en figures de Bernard de Montfaucon. Histoire d’un livre, le premier consacré à ce musée de papier, dirigé par Véronique Krings (Bordeaux, Éditions Ausonius, 2021, 2 vol. et un carnet illustré). Sur ce même questionnement, le colloque international
« Antiquaires voyageurs (XVIe-XIXe siècles) » co-organisé par Véronique Krings s’est tenu à Rome les 26-28 juin 2024 (https://antiquaires.hypotheses.org/juin-2024-antiquaires-voyageurs-xvie-xixe-siecles). Il s’inscrit dans le cadre des activités du groupe de recherche « Dans l’œil des antiquaires », dont Véronique Krings est co-ordonnatrice. Il s’agit d’un espace de rencontres pour ceux qui, par ce biais, s’intéressent à la réception de l’Antiquité et du Moyen Âge jusqu’à nos jours (cinq séminaires entre juin 2020 et octobre 2022, https://antiquaires.hypotheses.org/).
La participation au colloque de Genève sur les œuvres orphelines, et à la publication qui en est issue (Bâle, Helbing Lichtenhahn, 2023), a donné l’occasion de souligner l’apport des sources antiquaires à cette problématique très actuelle.
Par ailleurs, Véronique Krings est co-éditrice de De la source au jardin. La Fontaine de Nîmes (Drémil-Lafage, Éditions Mergoil, 2023), un ouvrage qui poursuit les enquêtes sur la réception de l’Antiquité à Nîmes et dans le Midi de la France.
Anne-Hélène Klinger-Dollé et Véronique Krings, en collaboration avec Pierre-Yves Lacour (université Paul Valéry-Monpellier 3, CRISES) et François Pugnière (chercheur associé à CRISES), ont organisé en 2019 au musée de la Romanité de Nîmes le colloque international « Donner à voir l’Antiquité : genèse, circulation et fonctions des représentations figurées de l’Antique (XVIe-XIXe siècle) » (https://voirlantiquite.sciencesconf.org/). Les Actes paraîtront aux Éditions Ausonius début 2025, sous la direction d’Anne-Hélène Klinger-Dollé, Véronique Krings et François Pugnière.
Notre axe a pris une part active au projet « Questions d’images », dirigé par Anne-Hélène Klinger-Dollé (https://utpictura18.univ-amu.fr/rubriques/ressources/images-reception-lantiquite, 16 articles). Ce dossier est complété par cinq textes d’accompagnement pédagogiques sur le site Imago. Lire du latin illustré (https://imago-latin.fr/questions-d-images/images-et-reception-de-lantiquite/).
La vulgarisation et le lien avec l’enseignement est aussi au cœur du projet Imago. Lire du latin illustré, site internet pédagogique (https://imago-latin.fr/) créé par Anne-Hélène Klinger-Dollé en 2019. Il propose des ressources en ligne gratuites pour l’enseignement secondaire et supérieur pour faire faire du latin à partir de corpus néo-latins illustrés (XIVe-XVIIe siècle).
Un article analyse cette expérience : A.-H. Klinger-Dollé, « Textes néo-latins humanistes et images renaissantes : un ludus seriosus pédagogique », dans La Lecture antique en V. O. Lire en classe des textes latins et grecs aujourd’hui, dir. A. Estèves et Fl. Kimmel-Clauzet, Grenoble, UGA Éditions, 2021, p. 83-106.

