-
Partager cette page
Axe 1 : Les textes et la langue
Plan de page
a) Edition, traduction et commentaire de textes
L’édition de textes, la traduction et le commentaire constituent le cœur de métier de plusieurs membres qui travaillent en association avec d’autres équipes et laboratoires français, le plus souvent pour des éditions de la Collection « Budé ».
Sans viser ici l’exhaustivité sur les nombreux projets en cours ou achevés récemment, É. Foulon a publié, en collaboration avec M. Molin (Paris XIII), les livres LXXVIII-LXXX de Cassius Dion en 2020 (Paris, Les Belles Lettres, Collection des Universités de France ; ouvrage couronné par le prix Raymond Weil en 2021), et les livres XXII-XXIX de Polybe en 2024 (Paris, Les Belles Lettres, Collection des Universités de France) ; il travaille actuellement, toujours en collaboration avec M. Molin, sur les livres XXX-XXXIV de Polybe et sur les livres LXXI-LXXIV de Cassius Dion. J. Bocholier, qui a rejoint le CRATA en 2023, a édité, traduit et commenté les Héraclides d’Euripide en 2024 (Paris, Les Belles Lettres, coll. « Études anciennes »).
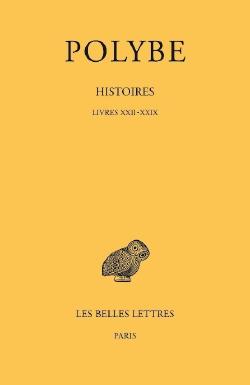
R. Courtray, après avoir publié en 2019, une édition du Commentaire sur Daniel de Jérôme (SC 602), a préparé, dans le cadre de son HDR (janvier 2024), une édition du Contre Helvidius. Sur la virginité perpétuelle de la bienheureuse Marie de Jérôme, qui paraîtra prochainement dans la collection « Sources Chrétiennes » (Éditions du Cerf, SC 653).
J.-C. Carrière travaille actuellement sur l’édition, la traduction et le commentaire de papyrus latins et surtout grecs d’Égypte, d’époque impériale (IIe-IIIe s. ; lettres privées). R. Courtray et J.‑C. Carrière ont également proposé dernièrement, en deux volumes parus dans les Cahiers de la Lomagne, une anthologie de textes traduits relatifs à la Toulouse antique, du IIIe s. av. J.-C. au Ve s. de notre ère.
Des doctorantes et des doctorants du CRATA éditent également des textes anciens : B. Chachuat sur le chant VII de Lucain (thèse soutenue en 2021) ; L. Thérond-Débat sur les livres LXXV-LXXVII de Cassius Dion (thèse soutenue en 2023. Une thèse soutenue durant le précédent quinquennal, en 2015, par une ancienne doctorante du CRATA, M. Platon, fait aussi l’objet actuellement d’un travail de publication : ce travail concerne les livres LVII-LVIII de Cassius Dion. Durant le quinquennal actuel, les doctorantes et des doctorants du CRATA ont entamé avec les chercheurs titulaires de l’équipe plus expérimentés une véritable réflexion sur les méthodes d’édition de texte. Dans le but d’échanger sur ce thème, ils ont organisé le 15 février 2021 une journée d’étude intitulée « Éditer les Anciens aujourd’hui » (organisée par É. Balavoine et B. Chachuat). 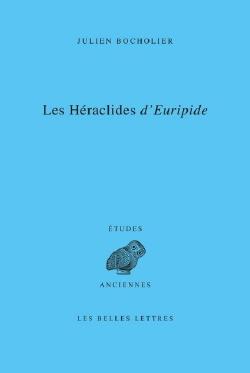
Indépendamment de l’édition de textes et de la traduction, les membres du CRATA sont nombreux à publier régulièrement des travaux qui relèvent du domaine du commentaire, ou plus largement de l’étude littéraire des auteurs anciens. Ceux, par exemple, de M. Armisen-Marchetti sur Sénèque ont été rassemblés récemment par plusieurs membres du CRATA (J.-P. Aygon, J.-C. Courtil et F. Ripoll) : Seneca saepe noster. Articles de M. Armisen-Marchetti sur l’œuvre de Sénèque (1981-2013) réunis en son honneur, Bordeaux, Ausonius, « Scripta Antiqua » 138, 2020. Des manifestations scientifiques sur des thématiques littéraires portant sur les auteurs anciens sont régulièrement organisées par des membres du CRATA : on signalera par exemple la journée d’étude organisée par F. Ripoll sur « la loi des séries » le 21 octobre 2022 à Toulouse (actes publiés par F. Ripoll : La loi des séries, dans Pallas 124, Toulouse, PUM, 2024).
Certains membres du CRATA ont été ou sont impliqués dans des projets internationaux concernant les études littéraires, ainsi F. Ripoll dans le projet international lancé en 2016 par Chr. Reitz et S. Finkmann, de l’Université de Rostock (projet Epische Bauformen - Structures of Epic Poetry, visant à produire une grande étude synthétique des scènes typiques dans l’épopée gréco-latine : 4 volumes, 3500 pages, 60 contributeurs internationaux, avec une double participation au volume 2 publié en 2019).
b) La langue : structures et étymologies (grec et latin)
Ce sous-axe concerne en particulier la linguistique, d’un point de vue aussi bien synchronique que diachronique. É. Dieu a poursuivi durant le dernier quinquennal ses travaux sur l’accentuation grecque, qui ont abouti notamment à la publication d’un Traité d’accentuation grecque en 2022 (Innsbruck, collection des « Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft » ; ouvrage couronné par le prix Alfred Croiset de l’Académie des inscriptions et belles-lettres en 2023). Il publie régulièrement sur l’étymologie grecque, et participe 
En ce qui concerne l’étude de la langue d’un point de vue pédagogique, plusieurs latinistes des équipes CRATA et ERASME ont publié en 2018 aux éditions Ellipses un manuel Apprendre le latin, constamment révisé depuis (3e édition revue en 2024).
D’autres projets coordonnés par des membres du CRATA, ou auxquels des membres du CRATA participent, concernent pour une part la lexicologie : il s’agit de deux projets qui abordent respectivement les mots et les réalités relatifs au métal pour le premier (projet « METALLA »), au bois pour le second (projet « Les mots du bois en grec du linéaire B au grec byzantin »). Ces deux projets sont au croisement des axes 1 et 2 du CRATA : pour plus de détails, voir la présentation de l’axe 2 (« L’objet dans tous ses états »), sous-axe b (« Instrumenta. Le métal et le bois : technique et symbolique »).
c) Penser avec la Bible : les modèles bibliques chez les Pères de l'Eglise
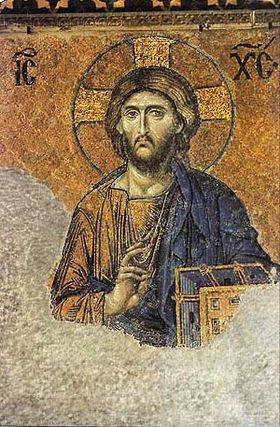
Adossé au réseau patristique développé lors du précédent quinquennal avec les Universités de Montpellier et de Louvain, cet axe propose d’étudier les pratiques discursives et exégétiques qui ont permis aux premiers écrivains chrétiens de penser les points essentiels de la doctrine chrétienne à travers les archétypes et figures que leur offrait le texte biblique. Les recherches menées peuvent partir de tel point de doctrine (théologie, morale, question de société...) pour étudier comment il a été expliqué grâce à tel(s) personnage(s) biblique(s) (ainsi, la résurrection pensée à travers les figures de Jonas, Daniel, Suzanne…) ou, à l’inverse, partir d’un personnage pour montrer comment il a été utilisé pour expliquer tel article de foi (par exemple, Marie pour penser la virginité). En juin 2021, un colloque co-organisé par R. Courtray a abordé la figure de Jésus, avec le thème : « Du Jésus des Écritures au Christ des théologiens. Les Pères de l’Église lecteurs de la vie de Jésus. » (publié dans les Cahiers de Biblia Patristica et en open access). Un autre colloque s’est intéressé en 2023 à « la Bible et ses lecteurs chez les Pères de l’Église » (publication en cours). R. Courtray a soutenu en 2024 une HDR sur Marie comme figure de virginité chez Jérôme (publication en cours dans la collection « Sources Chrétiennes »).

